page 6
LA DECOUVERTE DES OGM
L’homme a toujours voulu contrôler, manipuler comprendre son corps et son environnement.
Depuis le milieu du 19ème siècle (1956), la génétique a été découverte par Mendel. La génétique est la science dont l’objet est l’hérédité, elle permet la transmission des caractères héréditaires. Ce terme regroupe un nombre important de disciplines, la plupart associée à la biologie.
Après la découverte du code génétique au début des années 60, les techniques de laboratoire se sont mises en place dans les années 70 pour réaliser les premières manipulations génétiques.
En effet, c’est en 1973, qu’on aperçoit les premières manipulations génétiques. C’est à cette date que fût identifié le plasmide Ti dans la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Ce plasmide permet d’accueillir le gène porteur du caractère recherché, qu’il est en mesure d’introduire dans le génôme d’une plante.
En 1983, les chercheurs ont obtenu la première plante transgénique qui est une plante de tabac au stade expérimentale. Le maïs, la tomate, le colza, … par la suite ont été modifiés.
En 1985, ils réussirent à mettre au point une plante capable de résister à un insecte permettant ainsi d’arrêter les ravages des champs agricoles.
Puis deux ans après en 1987, ils créent pour la première fois une plante tolérant un herbicide total.
En 1988, première céréale transgénique sortant des laboratoires (c’est un maïs resistant à la Kanamycine).
Après toutes ces découvertes, ce n’est qu’en 1990 que le premier OGM fut commercialisé.
En 2002, 58.7 millions d’hectares de plantes transgéniques sont cultivées dans le monde.
L 'introduction ou la suppression d’un gène dans une cellule ou, la modification de ce gène sont des manipulations permettant la fabrication des OGM. Donc un OGM est un organisme génétiquement modifié, c’est à dire un organisme vivant dont le génome a été modifié par l’homme et cette modification se transmet à la “ descendance ”. Une plante ou un animal transgénique est un être vivant dont le génome a été modifié (c’est à dire qu’un gène a été remplacé, les être vivants modifiés ont alors un changement de caractères (ADN).
Pour les animaux, on observe le début des manipulations en 1981 avec la souris, en 1985 avec le porc , le mouton en 1987, la vache en 1991 … Donc les OGM concernent aussi bien les animaux que les végétaux bien que dans les journaux et autres sources d'information, nous entendions plus souvent parler des plantes transgéniques.
Un organisme génétique est un OGM, c’est à dire un organisme dont on a inséré un (ou plusieurs) gène(s) étranger(s) afin qu’il(s) synthétise(nt) une (ou plusieurs) protéines qu’il(s) ne synthétisai(en)t pas avant et ce sans effectuer de croisement mais en utilisant des biotechnologies. Nous allons donc maintenant regarder les différentes étapes de la fabrication d’un OGM.
1) La première étape constitue à isoler la protéine d’intérêt (celle que l’on cherche à produire). Une protéine est une suite d’acides aminés : on découpe ces acides aminés avec l’aide d’enzymes dont on connaît leurs caractéristiques de découpage des protéines (c’est à dire à qu’elle endroit elle va couper la protéine). Ensuite par l’intermédiaire d’un traitement informatique, on retrouve la séquence des acides aminés de la protéine. Suite à ce traitement informatique, on en déduit la séquence d’ADN responsable de la synthèse de cette protéine grâce au code génétique, puis on cherche cette séquence d’ADN dans le génome de l’organisme dans lequel on veut extraire le gène d’intérêt. Après cette premoère opération, nous connaissons donc maintenant la séquence d’ADN du gène d’intérêt, il nous faut ensuite la récupérer.
2) Dans une seconde étape, on cultive des cellules porteuses du gène d’intérêt que l’on souhaite, puis on récupère leur ADN. Une fois l’ADN en solution , on utilise la méthode dite de PCR (polymérase chain reaction) pour multiplier le matériel génétique.
3)Ensuite, il faut récupérer le gène d’intérêt. Pour ce faire, on utilise des enzymes restrictives judicieusement choisies. Le but de ces enzymes est de localiser certaines séquences de nucléotides sur l’ADN : celles-ci sont en général palindromiques (c’est à dire que les nucléotides sont dans le même ordres qu’on les lisent d’un sens ou d’un autre. La scission au niveau de la molécule obéit à un schéma particulier :
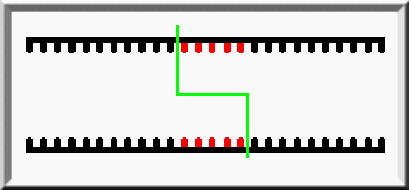
-en noir l'ADN
-en vert la coupure enzymatique
-en rouge la séquence reconnue par l'enzyme restrictive.
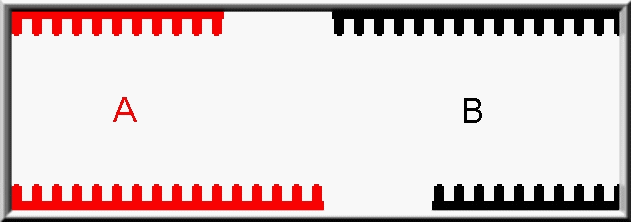
4) Après la scission, on obtient donc un gène d’intérêt avec deux bouts collants à ses extrémités. Par la suite, on récupère un plasmide d’une bactérie en la faisant éclater à l’aide d’une solution hypotonique, c'est à dire plus concentrée en eau. En utilisant les mêmes enzymes restrictives que pour l’extraction du gène d’intérêt, on “ ouvre ” ce plasmide pour extraire les gènes pathologiques que l’on substituera par le gène d’intérêt grâce à la complémentarité des “ bouts collants ”. On modifie ensuite ce plasmide en rajoutant un promoteur tel qu’un gène de résistance à un antibiotique ou encore de résistance à un herbicide.
De plus, on peut éliminer les séquences inutiles et adapter les séquences du gène d’intérêt en fonction du végétal ciblé. Il est vrai que chaque organisme n’utilise pas les mêmes séquences de bases pour coder les acides aminés d’une protéine.
5) On utilise l’électroporation qui consiste à couvrir la paroi de la bactérie Escherichia Coli par un choc électrique afin que le plasmide soit intégré dans celle-ci. Ensuite, nous procèdons à des cultures de bactéries que l’on place dans un milieu nutritif vital à leur développement (boîte de pétri) pour leur permettre de ce dupliquer après avoir introduit un antibiotique dans le milieu : seules les bactéries ayant intégrées le plasmide vont se multiplier permettant d’avoir une grande quantité du plasmide qui nous intéresse.
6) L'étape suivante consiste soit à introduire ce plasmide modifié dans une agrobactérie qui elle même sera par la suite introduite dans un organisme, ou soit d'introduire le plasmide modifié directement dans l'organisme cible, technique utilisée pour les animaux et les plantes résistantes aux agrobactéries.
Il y a 3 façon de transférer le plasmide modifié de l’Escherichia coli à l’Agrobacterium tumefaciens. Ces 3 méthodes sont :
- La conjugaison de bactéries : la conjugaison de bactéries est une méthode non sexuée mais de bactéries ayant un sexe différent, leur permettant de s’échanger des informations génétiques. En effet, il se fait une transmission de plasmides entre une bactérie donneuse et une bactérie réceptrice. Et potentiellement, ce plasmide s’intègre au génome de la bactérie réceptrice.
- La transformation de bactéries : la transformation “ naturelle ” ou physiologique est la première méthode de transfert du matériel génétique connu. En effet, le plasmide porteur du gène d’intérêt donc de l’ADN voulu se retrouve libre, nu et en solution, il est par la suite introduit dans une bactérie réceptrice, et par la suite l’ADN va s’intégrer au chromosome.
- La transduction de bactéries : la transduction est un mécanisme de transfert de matériel génétique d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse suivi de recombinaison par l'intermédiaire d'un vecteur qui est un bactériophage.
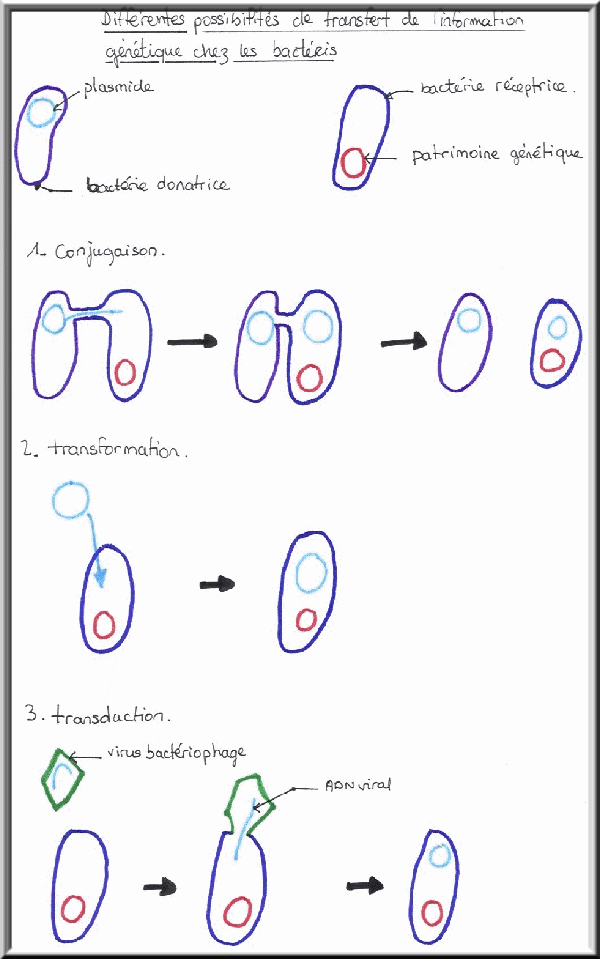
Sur le schéma ci-dessus, on peut observer le processus des différentes méthodes de transfert du plasmide modifié d’une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice.
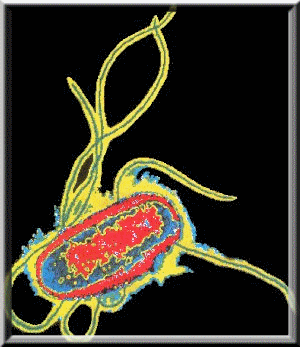
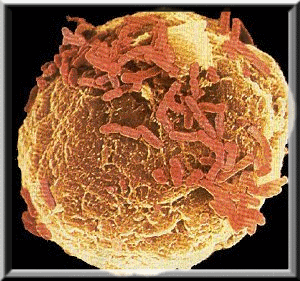
Après transfert du plasmide modifié dans l’agrobactérie et la multiplication de celle-ci, on introduit dans le milieu un antibiotique permettant de repérer les bactéries ayant intégrées le plasmide. En effet, celles ne l’ayant pas intégrées seront immédiatement détruites par l’antibiotique car elles n’ont pas obtenu le plasmide leur permettant d’avoir la capacité de résistance à cet antibiotique.
Ensuite, on place en culture l’Agrobacterium tumefaciens porteur du plasmide modifié avec des protoplastes de la plante à modifier. Les protoplastes utilisés sont des cellules qui sont dénué de membrane plasmique. Ce gène d’intérêt est ainsi transmis dans le noyau d’une cellule végétale qui par la suite va s’intégrer à son génome grâce au caractéristique de l’agrobactérie qui sont de transmettre avec facilité ses plasmides.
Le tissu végétal modifié obtenu est mis en culture. On obtient ainsi l’OGM souhaité.
Ainsi pour assurer le bon développement de cet OGM, il faut le placer dans un milieu de culture propice à son développement ( solution nutritive + facteur de croissance ).
Puis après que celui-ci se soit bien développé, on vérifie que le matériel génétique est fonctionnel. On pulvérise par exemple les plantes d’un herbicide (ces plantes sont censées avoir reçues un plasmide ayant la caractéristique de résister aux herbicides ), seules les plantes ayant bien intégrées le gène d’intérêt survivront à ce traitement. Il nous reste donc des plantes génétiquement modifiées. Néanmoins on peut se demander quels sont les modalités pour breveter une telle invention et quelles caractéristiques celle-ci doit elle respecter.
Depuis le milieu du 19ème siècle (1956), la génétique a été découverte par Mendel. La génétique est la science dont l’objet est l’hérédité, elle permet la transmission des caractères héréditaires. Ce terme regroupe un nombre important de disciplines, la plupart associée à la biologie.
Après la découverte du code génétique au début des années 60, les techniques de laboratoire se sont mises en place dans les années 70 pour réaliser les premières manipulations génétiques.
En effet, c’est en 1973, qu’on aperçoit les premières manipulations génétiques. C’est à cette date que fût identifié le plasmide Ti dans la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Ce plasmide permet d’accueillir le gène porteur du caractère recherché, qu’il est en mesure d’introduire dans le génôme d’une plante.
En 1983, les chercheurs ont obtenu la première plante transgénique qui est une plante de tabac au stade expérimentale. Le maïs, la tomate, le colza, … par la suite ont été modifiés.
En 1985, ils réussirent à mettre au point une plante capable de résister à un insecte permettant ainsi d’arrêter les ravages des champs agricoles.
Puis deux ans après en 1987, ils créent pour la première fois une plante tolérant un herbicide total.
En 1988, première céréale transgénique sortant des laboratoires (c’est un maïs resistant à la Kanamycine).
Après toutes ces découvertes, ce n’est qu’en 1990 que le premier OGM fut commercialisé.
En 2002, 58.7 millions d’hectares de plantes transgéniques sont cultivées dans le monde.
L 'introduction ou la suppression d’un gène dans une cellule ou, la modification de ce gène sont des manipulations permettant la fabrication des OGM. Donc un OGM est un organisme génétiquement modifié, c’est à dire un organisme vivant dont le génome a été modifié par l’homme et cette modification se transmet à la “ descendance ”. Une plante ou un animal transgénique est un être vivant dont le génome a été modifié (c’est à dire qu’un gène a été remplacé, les être vivants modifiés ont alors un changement de caractères (ADN).
Pour les animaux, on observe le début des manipulations en 1981 avec la souris, en 1985 avec le porc , le mouton en 1987, la vache en 1991 … Donc les OGM concernent aussi bien les animaux que les végétaux bien que dans les journaux et autres sources d'information, nous entendions plus souvent parler des plantes transgéniques.
Un organisme génétique est un OGM, c’est à dire un organisme dont on a inséré un (ou plusieurs) gène(s) étranger(s) afin qu’il(s) synthétise(nt) une (ou plusieurs) protéines qu’il(s) ne synthétisai(en)t pas avant et ce sans effectuer de croisement mais en utilisant des biotechnologies. Nous allons donc maintenant regarder les différentes étapes de la fabrication d’un OGM.
1) La première étape constitue à isoler la protéine d’intérêt (celle que l’on cherche à produire). Une protéine est une suite d’acides aminés : on découpe ces acides aminés avec l’aide d’enzymes dont on connaît leurs caractéristiques de découpage des protéines (c’est à dire à qu’elle endroit elle va couper la protéine). Ensuite par l’intermédiaire d’un traitement informatique, on retrouve la séquence des acides aminés de la protéine. Suite à ce traitement informatique, on en déduit la séquence d’ADN responsable de la synthèse de cette protéine grâce au code génétique, puis on cherche cette séquence d’ADN dans le génome de l’organisme dans lequel on veut extraire le gène d’intérêt. Après cette premoère opération, nous connaissons donc maintenant la séquence d’ADN du gène d’intérêt, il nous faut ensuite la récupérer.
2) Dans une seconde étape, on cultive des cellules porteuses du gène d’intérêt que l’on souhaite, puis on récupère leur ADN. Une fois l’ADN en solution , on utilise la méthode dite de PCR (polymérase chain reaction) pour multiplier le matériel génétique.
3)Ensuite, il faut récupérer le gène d’intérêt. Pour ce faire, on utilise des enzymes restrictives judicieusement choisies. Le but de ces enzymes est de localiser certaines séquences de nucléotides sur l’ADN : celles-ci sont en général palindromiques (c’est à dire que les nucléotides sont dans le même ordres qu’on les lisent d’un sens ou d’un autre. La scission au niveau de la molécule obéit à un schéma particulier :
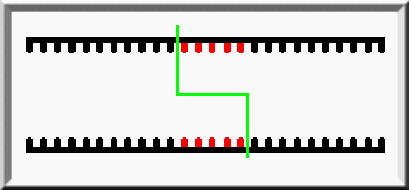
-en noir l'ADN
-en vert la coupure enzymatique
-en rouge la séquence reconnue par l'enzyme restrictive.
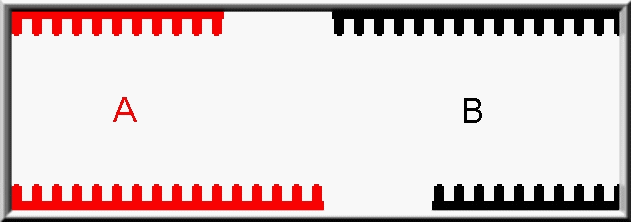
4) Après la scission, on obtient donc un gène d’intérêt avec deux bouts collants à ses extrémités. Par la suite, on récupère un plasmide d’une bactérie en la faisant éclater à l’aide d’une solution hypotonique, c'est à dire plus concentrée en eau. En utilisant les mêmes enzymes restrictives que pour l’extraction du gène d’intérêt, on “ ouvre ” ce plasmide pour extraire les gènes pathologiques que l’on substituera par le gène d’intérêt grâce à la complémentarité des “ bouts collants ”. On modifie ensuite ce plasmide en rajoutant un promoteur tel qu’un gène de résistance à un antibiotique ou encore de résistance à un herbicide.
De plus, on peut éliminer les séquences inutiles et adapter les séquences du gène d’intérêt en fonction du végétal ciblé. Il est vrai que chaque organisme n’utilise pas les mêmes séquences de bases pour coder les acides aminés d’une protéine.
5) On utilise l’électroporation qui consiste à couvrir la paroi de la bactérie Escherichia Coli par un choc électrique afin que le plasmide soit intégré dans celle-ci. Ensuite, nous procèdons à des cultures de bactéries que l’on place dans un milieu nutritif vital à leur développement (boîte de pétri) pour leur permettre de ce dupliquer après avoir introduit un antibiotique dans le milieu : seules les bactéries ayant intégrées le plasmide vont se multiplier permettant d’avoir une grande quantité du plasmide qui nous intéresse.
6) L'étape suivante consiste soit à introduire ce plasmide modifié dans une agrobactérie qui elle même sera par la suite introduite dans un organisme, ou soit d'introduire le plasmide modifié directement dans l'organisme cible, technique utilisée pour les animaux et les plantes résistantes aux agrobactéries.
Il y a 3 façon de transférer le plasmide modifié de l’Escherichia coli à l’Agrobacterium tumefaciens. Ces 3 méthodes sont :
- La conjugaison de bactéries : la conjugaison de bactéries est une méthode non sexuée mais de bactéries ayant un sexe différent, leur permettant de s’échanger des informations génétiques. En effet, il se fait une transmission de plasmides entre une bactérie donneuse et une bactérie réceptrice. Et potentiellement, ce plasmide s’intègre au génome de la bactérie réceptrice.
- La transformation de bactéries : la transformation “ naturelle ” ou physiologique est la première méthode de transfert du matériel génétique connu. En effet, le plasmide porteur du gène d’intérêt donc de l’ADN voulu se retrouve libre, nu et en solution, il est par la suite introduit dans une bactérie réceptrice, et par la suite l’ADN va s’intégrer au chromosome.
- La transduction de bactéries : la transduction est un mécanisme de transfert de matériel génétique d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse suivi de recombinaison par l'intermédiaire d'un vecteur qui est un bactériophage.
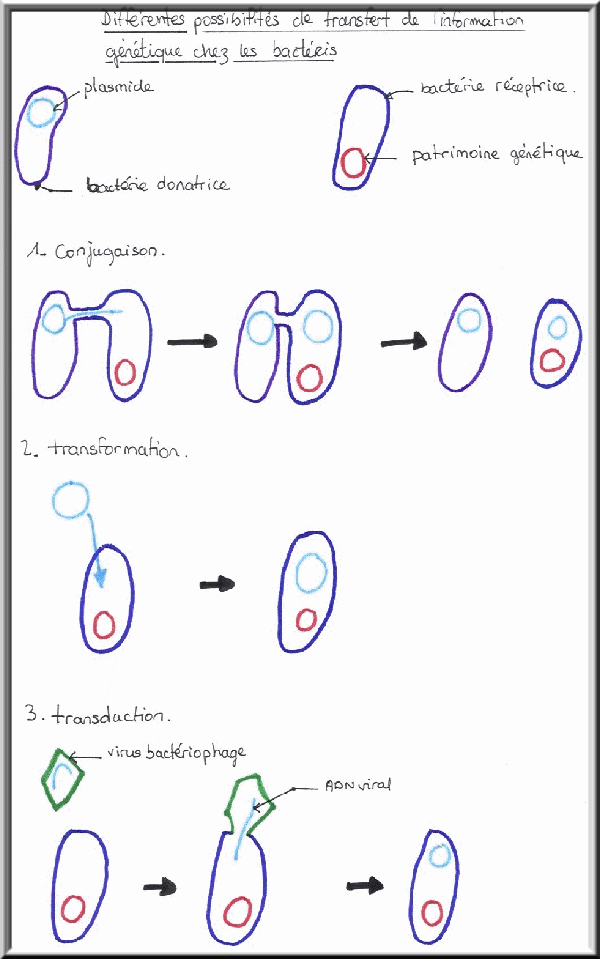
Sur le schéma ci-dessus, on peut observer le processus des différentes méthodes de transfert du plasmide modifié d’une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice.
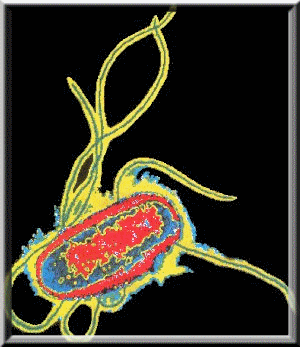
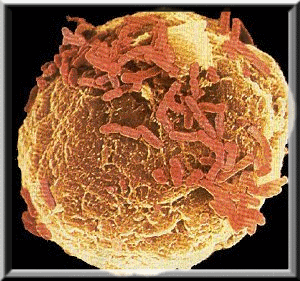
Après transfert du plasmide modifié dans l’agrobactérie et la multiplication de celle-ci, on introduit dans le milieu un antibiotique permettant de repérer les bactéries ayant intégrées le plasmide. En effet, celles ne l’ayant pas intégrées seront immédiatement détruites par l’antibiotique car elles n’ont pas obtenu le plasmide leur permettant d’avoir la capacité de résistance à cet antibiotique.
Ensuite, on place en culture l’Agrobacterium tumefaciens porteur du plasmide modifié avec des protoplastes de la plante à modifier. Les protoplastes utilisés sont des cellules qui sont dénué de membrane plasmique. Ce gène d’intérêt est ainsi transmis dans le noyau d’une cellule végétale qui par la suite va s’intégrer à son génome grâce au caractéristique de l’agrobactérie qui sont de transmettre avec facilité ses plasmides.
Le tissu végétal modifié obtenu est mis en culture. On obtient ainsi l’OGM souhaité.
Ainsi pour assurer le bon développement de cet OGM, il faut le placer dans un milieu de culture propice à son développement ( solution nutritive + facteur de croissance ).
Puis après que celui-ci se soit bien développé, on vérifie que le matériel génétique est fonctionnel. On pulvérise par exemple les plantes d’un herbicide (ces plantes sont censées avoir reçues un plasmide ayant la caractéristique de résister aux herbicides ), seules les plantes ayant bien intégrées le gène d’intérêt survivront à ce traitement. Il nous reste donc des plantes génétiquement modifiées. Néanmoins on peut se demander quels sont les modalités pour breveter une telle invention et quelles caractéristiques celle-ci doit elle respecter.
page 6


