page 13
LES "ANTI-OGM"
De nombreuses associations politiques ou non politiques s’insurgent, notamment en France, contre les OGM et les grandes firmes internationales les concevant.
ATTAC, Greenpeace, Terre sacrée, ou encore Alerte OGM font partie des associations les plus puissantes et donc les plus représentées. Greenpeace ne compte pas moins de 3 000 000 d’adhérents dans le monde, ATTAC 21600 en France. Leurs actions sont nombreuses comme des fauchages d’OGM, des pétitions anti-OGM, de véritables investigations pour les plus puissantes comme Greenpeace.
Des parties politiques, écologiques pour la plupart, n’acceptent pas les OGM. Un des plus connus en France est "Les Verts". Ce parti ne milite pas simplement pour l’environnement mais pour une société plus sociale.
Tout d’abord, nous allons voir quelles sont les revendications des opposants aux OGM. Ensuite nous nous demanderons quels sont les atouts des OGM.
1) Les menaces sur l’environnement
Qu’est-ce que la biodiversité ?
Le grand scientifique américain, Edward O. Wilson, considéré comme l’inventeur du mot biodiversité, en donne la définition suivante : « la totalité de toutes les variations de tout le vivant »Selon les scientifiques, la biodiversité est la dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se décline en diversité écologique (les milieux), diversité spécifique (les espèces), et diversité génétique.
La biodiversité exprime deux notions essentielles :
- la biodiversité, c’est tout le vivant, y compris l’homme. C’est toutes les espèces végétales et animales recensées sur terre qui sont apparues naturellement.
- La biodiversité c’est aussi, les interactions existantes entre les espèces. Lorsqu’une espèce disparaît notamment à cause des Ogm, c’est tout une chaîne alimentaire qui est déstabilisée, c’est pourquoi d’autres espèces peuvent disparaître.
La perte de la notion d’espèce
Bien que les études scientifiques sur les risques des OGM ne soient pas nombreuses, certaines études ont tout de même réussi à en prouver certains.
D’une part, la notion d’espèce animale ou végétale vient à disparaître. Avec la technique des OGM, on pourra introduire un gène d’une espèce quelconque dans une autre espèce différente. La notion d’espèce vivante disparaîtrait, on ne parlera plus d’espèce mais de création par mélange.
D’autres part, les espèces végétales ou animales seront sélectionnés pour leurs qualités, qu’elles soient résistantes, qu’elles poussent vite. La diversité des plantes, des légumes est menacée. Le savoir faire des agriculteurs acquis au fil des générations ne sera que bagatelles. Une seule variété sera cultivée et les autres à cause de leur pauvre rendement disparaîtront.
Les menaces écologiques
La pollution
Tout d’abord, l’environnement sera de plus en plus pollué. Lorsqu’un gène qui a pour but de rendre une plante résistante à un insecticide est mise en place, l’agriculteur peut abuser de l’insecticide. L’environnement sera pollué, les nappes phréatiques et les rivières enregistreront une un taux de pollution accrue. Un exemple est l’introduction d’un gène tolérant le round up dans un soja transgénique par la firme Monsanto elle-même vendeuse de ce fameux round up. Cette firme augmente ainsi ses ventes d’insecticide, lequel est utilisé à tout vas par les agriculteurs.
Colonisation des OGM, atteinte à la biodiversité.
Les plantes transgéniques ont pour but de mieux résister aux prédateurs ou aux parasites naturels, ce qui leur confère un avantage comparatif par rapport aux variétés naturelles locales et risque de conduire à la disparition de ces dernières et donc à un appauvrissement de la biodiversité. Cela est particulièrement grave, car ce sont ces variétés locales qui fournissent les ressources génétiques nécessaires pour améliorer les plantes cultivées, qui deviendraient par exemple victimes de nouvelles maladies. Signalons aussi le danger économique que représenterait la dépendance du monde agricole vis-à-vis d'une multinationale unique pour son approvisionnement en semences de maïs ou de colza.
Atteinte à la biodiversité ?
Certains scientifiques estiment que la diffusion de la biotechnologie conduira à un appauvrissement de la diversité génétique, en conférant un même gène à de nombreuses espèces. Cet effet serait un facteur de vulnérabilité pour les cultures. Notons que d'autres pensent, au contraire que l'utilisation de transgenèses peut être un moyen d'augmenter la diversité génétique, en créant à partir de la même structure plusieurs plantes différentes ayant chacune des spécialités propres à elle seule, grâce à l'apparition de nouveaux gènes. Deux points de vue s’opposent mais un est indiscutable. Si les ogm colonise les territoires, cela se fera au dépourvu d’autres espèces naturelles, lesquelles disparaîtront.
Transmission de gènes par pollinisation et croisements inter variétaux
On sait aujourd'hui que les plantes cultivées échangent, par croisements spontanés, leurs gènes avec les espèces sauvages apparentées, qui sont souvent de mauvaises herbes. En France, des études récentes menées à l'INRA (Institut National de Recherche Agronomique) ont montré que le gène de résistance à un herbicide implanté dans le colza pouvait se retrouver dans une mauvaise herbe apparentée, la ravenelle. Celle-ci devient alors fertile et insensible aux herbicides, une super mauvaise herbe. Cela est encore plus grave si ce phénomène agit entre les cultures. Par exemple un maïs génétiquement modifié produisant une protéine contre un insecte pourrait contaminer un champ de colza aux alentours. Le colza produirait lui aussi cette protéine. L’agriculteur, croyant vendre un colza naturel vendra un colza génétiquement modifié. On appelle cela le flux de gènes Ce flux de gène génère une "pollution génétique" qui, à l'inverse de la pollution chimique ou radioactive, est totalement irréversible. On ne pourra jamais rapporter au laboratoire un gène qui se serait échappé de la plante génétiquement modifiée. Ce gène est et sera dans la nature pour toujours.
La résistance des insectes
Les maïs transgéniques dont la culture est aujourd'hui autorisée en France contiennent un gène de la bactérie du sol Bacillus thuringiensis qui synthétise dans la plante une toxine, dite Bt, qui lui permet de se défendre contre un insecte : la pyrale du maïs. Contrairement à un insecticide classique, que l'on utilise à des moments précis, la plante transgénique produit la toxine en continu. L'insecte, étant au contact de cet insecticide d'une façon quasi permanente, va très vraisemblablement y devenir progressivement résistant. La toxine Bt sera alors inefficace à moyen terme et l'on devra de nouveau recourir aux insecticides toxiques que ces maïs devaient nous permettre d'éviter, augmentant ainsi la pollution des sols et des eaux, ou à de nouveaux maïs transgéniques. A moyen terme, ce processus recommencera et cette escalade aura pour seul résultat une pollution accrue de l'environnement.
L’impact sur les insectes et notamment sur une activité : l’apiculture.
En effet, il est important de vérifier que les plantes transgéniques ne soient pas toxiques pour d'autres insectes .Ce sont les insectes qui ne sont pas considérés comme " ravageurs " et qui peuvent même être bénéfiques pour l'écosystème, voire pour tout l'environnement, d'où leur nom d'insectes " utiles ". Exemples : les abeilles, les coccinelles, …aucune étude actuelle n’a démontré que les OGM présentaient un risque majeur sur ces insectes. L’apiculture est directement menacée :
- risques non évalués dus à l'ingestion de pollens et nectar porteurs des transgènes et leurs produits, au premier rang desquels les insecticides produits par des cultures OGM qui pourraient provoquer la mort des colonies d’abeilles
- risques non évalués sur le transfert et expression de transgènes, y compris de résistance aux antibiotiques, dans les microorganismes de l'intestin de l'abeille, voire ses tissus.
Cependant, il faut nuancer ces risques. Lorsqu ‘un ogm permet de ne pas utiliser d’insecticide, il protège indirectement les abeilles car ces dernières sont souvent victimes de désherbages intempestifs.( partie B)
2) Des Menaces annexes
Les risques potentiels sur les humains consommant les organismes génétiquement modifiés.
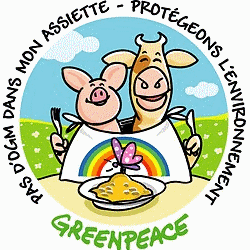 (Affiche de lutte anti-OGM)
(Affiche de lutte anti-OGM)
Les risques alimentaires sont peu connus car ils n'ont été que très peu étudiés. C'est donc le principe de précaution qui doit s'imposer selon les personnes opposées aux OGM. Ces arguments sont à prendre avec recul car aucun test rigoureux n’a encore été effectué.
Recrudescence des allergies
Nous savons que les allergies sont dues aux protéines présentent dans le corps humain ou dans l’environnement en général. Or toute protéine est le produit de l’expression d’un gène. Donc un nouveau gène introduit dans une plante ou autre va produire une protéine qui pourrait déclenchée chez certaines personnes des allergies. En effet, cette protéine pourrait être rejetée par l’organisme.
La perte d’efficacité des antibiotiques lorsqu’un gène de résistance à un antibiotique est introduit dans une plante.
Parmi les gènes introduits dans le maïs transgénique de Novartis, autorisé à la culture en France, se trouve un gène de résistance à un antibiotique commun, l'ampicilline. Ce gène est un marqueur, c'est-à-dire qu'il permet d'identifier les plantes ayant intégré les gènes d'intérêt (de synthèse de la toxine Bt dans le cas du maïs). Ce gène n'a ensuite plus aucune fonction, mais Novartis n'a pas jugé utile de l'extraire des plantes transgéniques.Les études menées par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur les antibiotiques montrent que ceux-ci deviennent de moins en moins efficaces, les bactéries qui y sont soumises devenant insensibles au bout d'un certain temps. De nombreux scientifiques craignent que la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques à partir des plantes génétiquement manipulées n'accélère ce processus entraînant l'apparition de bactéries pathogènes contre lesquels les antibiotiques seraient impuissants. Il faut souligner que les antibiotiques sont les seules armes efficaces que nous possédons contre elles, que la recherche peine à trouver de nouvelles molécules efficaces et que les maladies hospitalières liées aux résistances aux antibiotiques tuent 10 000 personnes par an.
Le manque de recul quand à ce phénomène récent.
Ce problème majeur persiste et seul le temps et les études pourront le résoudre. En effet, la réalisation d’OGM est récente. Les dangers représentés par les OGM doivent s'apprécier en tenant compte du caractère très récent des développements de la transgénèse. Ce que la nature a mis plusieurs milliards d'années à construire, des hommes sont prêts à le contrarier en quelques années. La structure de l'ADN, support moléculaire de l'hérédité, n'est connue que depuis 1953. Les enzymes de restriction, ces ciseaux chimiques permettant de couper des portions d'ADN et de les insérer dans l'ADN d'un autre organisme, n'ont été découvertes que dans les années 70.
La première plante transgénique, un tabac résistant à un antibiotique, a été créée il y a quinze ans seulement, et la première commercialisation d'une plante transgénique date de 1994, sans qu'il y ait eu de recul par rapport à des phénomènes qui peuvent avoir des conséquences écologiques, économiques, sociales.
La transgénèse s'apparente aujourd'hui à une espèce de bricolage : on essaie et on verra les conséquences plus tard, qu’elles soient désastreuses ou pas. On connaît encore relativement peu de choses sur l'ADN, sur le rôle et le fonctionnement des gènes, leurs interactions. Peut –on implanté les gènes d’une espèce dans une autre sans que cela ne modifie en rien la structure de la plante, son fonctionnement ?
Malgré l'imperfection des connaissances en génie moléculaire, malgré l'impact potentiel des disséminations de ces plantes manipulées, dans aucune autre discipline les applications commerciales ne suivent d'aussi près les découvertes scientifiques, qui deviennent le baromètre de la santé des multinationales à la bourse. C’est ce que nous verrons dans le paragraphe suivant :
Pour les semences, les dix plus grosses entreprises contrôlent un tiers du marché des semences commerciales.Les premières entreprises semencières sont Dupont (par l'intermédiaire de Pioneer notamment), Monsanto (EUA), Syngenta (suisse), Bayer (allemande). La compagnie allemande KWS AG est septième.
l’agriculture en danger
Comme vous pouvez l’observer sur la carte suivante, les OGM sont cultivés dans toute l’Amérique, en chine, en Inde et en Australie et dans quelques pays européen sans oublier l’Afrique du sud. Les principales plantes modifiées cultivées sont le maïs, le colza, le soja et le coton.
En chine, les multinationales se sont implantées sans aucune difficulté. La population chinoise augmente alors que la production de riz stagne. Les multinationales se sont déjà emparées d’une partie du marché agricole en Chine et les agriculteurs se voient dans l’obligation d’accepter ces semences transgéniques, c’est pourquoi l’agriculture est en danger
des agriculteurs dépendants
Le risque économique se pose en terme de dépendance des cultivateurs envers l’entreprise détentrice du brevet, ceux-ci devant payer chaque année une contrepartie financière pour avoir le droit de planter les semences concernées par le brevet. En effet, les brevets confèrent à l’entreprise l’exclusivité des reproductions des semences transgéniques. Il est vrai que la directive 98/44 n’autorise pas ces pratiques mais elle n’a pas encore été adoptée en France et dans de nombreux pays européens.
De tout temps, les paysans ont conservé une partie des graines obtenues pour les replanter la saison suivante. Ce “droit de l’agriculteur” est perçu par l’industrie des semences comme un “privilège du fermier” et une concurrence insupportable, face aux coûts grandissants de la recherche. En Amérique du Nord, plusieurs centaines de fermiers ont été poursuivis en justice par Monsanto pour avoir ressemé des variétés transgéniques brevetées. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien qui n’a jamais cultivé d’OGM, a été condamné pour recel de gènes brevetés par Monsanto dans sa culture de colza ! Les semences transgéniques brevetées sont souvent comparées à des logiciels informatiques du point de vue de la propriété intellectuelle ; elles ne peuvent légalement être multipliées par leurs utilisateurs. D’une année sur l’autre, les agriculteurs sont contraints par la loi d’acheter leurs semences au lieu de les reproduire. Dans les pays du Sud, outre l’aspect économique, ces pratiques de sélection et multiplication des semences locales servent à maintenir une diversité variétale adaptée à une large gamme de terroirs ; ces pratiques sont favorables à la conservation des ressources génétiques vitales pour l’humanité.
Des OGM incontrôlés
Un scandale a éclaboussé la chine. Des chercheurs de Greenpeace ont découvert que Des semences transgéniques sont vendues et cultivées illégalement dans la province chinoise de Hubei depuis 2 ans. Des échantillons de riz ont été récupérés auprès de revendeurs de semences, de paysans et de meuniers. Les analyses effectuées par le laboratoire international Genescan ont montré la présence d’ADN transgénique dans 19 échantillons. Ce marché « noir » des OGM prouve encore une fois que ces plantes ont plus un but commercial que alimentaire. selon une conseillère de green peace ce problème est grave car les analyses effectuées ont montré la présence d’une protéine soupçonnée de provoquer des allergies sur les consommateurs.
La recherche publique concurrencée et bafouée
Face à des contraintes économiques, à l’obligation de trouver de nouveaux débouchés et de créer de nouveaux marchés, des partenariats s’installent entre entreprises privées et publiques. Les nouvelles législations sur la recherche et l’innovation favorisent le rapprochement des universités et des grandes entreprises, qui peuvent ainsi imposer leur conception marchande du vivant. Par exemple, aux États-Unis, Novartis et Monsanto ont pris le contrôle de départements de recherche, respectivement de l’Université de Berkeley en Californie et de la Washington University, pour des contrats de centaines de millions de dollars. Les détenteurs de brevets n’acceptent de délivrer le matériel breveté qu’à condition d’avoir un compte-rendu régulier des recherches entreprises par les concurrents. Des chercheurs du domaine public, le plus souvent sous contrat avec le secteur privé, adoptent peu à peu la politique du secret. Le risque majeur de ces contrats est de voir les firmes biotechnologiques s’emparer de la recherche et où les états ne pourront que subir.
L’expansion illimitée des brevets
Si les lois encadrant la brevetabilité du vivant continuent à s’élargir, l’appropriation du patrimoine universel va se banaliser. N’importe qui, voulant déposer un brevet sur un organisme vivant (plante, animal) le fera sans aucunes contraintes. Les grandes firmes pourront ainsi développer toutes leurs capacités financières pour créer de nouveaux êtres vivants et les breveter. En effet, les coups des brevets sont très important et seuls les multinationales peuvent se permettre d’organiser les recherches et de déposer les brevets. On peut imaginer que le vivant sera dans un certain nombre d’années propriété de ….
Etude des dangers de l’implantation des OGM dans les pays du sud par les firmes : exemple du continent africain.
Les enjeux économiques
Nous savons tous que la production d’OGM coûte chère. Elle nécessite de la part des gouvernements de débloquer des fonds importants. Ainsi, la recherche sur les OGM n’est pas une priorité pour les pays pauvres, en voie de développement, et même certains pays riches. C’est pourquoi, la recherche et la production d’OGM sont souvent réalisées par des multinationales. Et qui dit multinationale, dit forcément profit. Les OGM constituent bien un enjeu économique considérable. Toute activité de recherche doit être rentabilisée par les activités commerciales de l’entreprise. De ce fait, pour trouver de débouchés à ces produits indésirables en Europe, l 'Afrique risque d 'être leur terrain de prédilection, sous prétexte que ce continent souffre de la faim. Or, il est bien connu que l 'Afrique produit suffisamment de nourriture pour nourrir tous ses fils, et que le problème crucial reste le transport des produits alimentaires entre des régions d’un même pays, ou entre des pays de différentes régions, comme c’est également le cas en Asie et en Amérique Latine. De plus, l 'Afrique dispose encore de ressources génétiques alimentaires non encore exploitées par la recherche scientifique nationale qui a du mal à financer ses activités la plupart du temps.
Ainsi, les intérêts économiques des sélectionneurs et des multinationales sont protégés, au détriment de ceux des agriculteurs et des communautés locales. Ces intérêts économiques des producteurs d 'OGM sont les principales raisons de l 'offensive actuelle des multinationales et de certaines coopérations des pays européens, sur toute l 'Afrique, ses organisations régionales ou sous-régionales (CEDEAO, UEMOA), et chacun des pays africains. Cette offensive vise à les contraindre à accepter sans précaution et sans tarder, l’introduction des OGM. Tout ceci n’a qu’un seul but, le profit.
De plus, les OGM produits par les entreprises ne font pas souvent l’objet de contrôle. L’offensive des multinationales en Afrique n’est donc pas contrôlée car très peu d’Etat africain est en mesure d’effectuer des tests rigoureux sur l’OGM qui sera peut-être cultivé chez eux demain. C’est le cas du coton Bt qui ne contrôle pas tous les insectes qui prolifèrent sur le coton en Afrique de l’Ouest. De ce fait, bien qu’en payant chère les semences transgéniques, le gain prétendu par la réduction de l’utilisation des pesticides n’est pas vérifié.
Les enjeux culturels et éthiques
En Afrique comme partout dans le monde entier, la diversité culturelle est liée à la diversité culinaire et à la diversité génétique. Quelles seraient les conséquences des modifications de la diversité génétique sur la diversité culturelle ? Par ailleurs, les interdits alimentaires ou les totems font partie des réalités africaines dans la plupart des villages et des régions. Que se passerait-il avec les OGM ?
Des échanges interdits.
Il importe de rappeler que les semences qui servent de point de départ à la création de variétés améliorées ou transgéniques sont issues des travaux de sélection et de conservation des agriculteurs et des communautés locales pendant des générations, des siècles ou des millénaires. Or, les droits des agriculteurs et des communautés locales ne sont pas reconnus au même titre que les droits de propriété intellectuelle des sélectionneurs et des producteurs d 'OGM. Il faut préciser que le brevetage du vivant est contraire à l’éthique africaine, qui a toujours consacré la propriété collective des semences et l’échange de ces dernières entre paysans, parents ou amis.
Toutes ces pratiques d’échanges de semences sont interdites avec les OGM. Les OGM, détenus par les multinationales ont fait l’objet d’un brevet et ils sont et ils restent l’exclusivité de l’entreprise. Un agriculteur achetant des semences transgéniques n’a en aucun cas le droit de les échanger avec un autre agriculteur. Et encore, il n’a le droit de ramasser les graines pour l’année suivante. Ainsi, on ignore les droits des agriculteurs et des communautés locales. Or, le groupe Afrique auprès de l 'Organisation Mondiale du Commerce à Genève a rejeté depuis le Sommet de Seattle en 1999, le brevet sur le vivant, et depuis Juillet 2001, les chefs d 'Etat de l 'Union Africaine ont adopté la loi modèle de l 'OUA sur la " Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et règles d’accès aux ressources biologiques ". Mais jusqu 'à ce jour, rare sont les pays qui ont légiféré pour protéger les droits des agriculteurs et des communautés locales de leur territoire national.
Une atteinte à la culture et aux coutumes
Enfin, les OGM posent également d’autres problèmes éthiques, dans la mesure où la barrière naturelle entre les espèces n’existe plus. En effet, les gènes insérés dans la plante améliorée viennent souvent d’une espèce étrangère. L’on peut même insérer un gène d’une espèce animale dans une espèce végétale et vice-versa. Connaissant l’importance des espèces animales et végétales dans la vie quotidienne des africains, à savoir l’alimentation, l’artisanat, la santé, et surtout la spiritualité, avec les interdits alimentaires, les totems,…, il y a lieu de se poser des questions à propos des OGM en Afrique. En effet, la contamination des plantes et des animaux par des OGM constitue une attaque à ce dont l'Afrique dispose de fondamental et de sacré, son patrimoine génétique (plantes et animaux d’Afrique).
Les enjeux politiques
Les multinationales accourent vers l’Afrique car elles y voient un marché formidable. Par leurs moyens financiers importants, elles exercent une pression sur des Etats africains faibles, pauvres dont on connaît leur fragilité. En effet, depuis les indépendances, les pays africains ayant toujours du mal à financer leur recherche scientifique agricole, l 'acceptation des OGM entraîne nécessairement la dépendance des pays africains vis-à-vis des multinationales et des laboratoires internationaux pour les semences et l 'alimentation. En effet, l’analyse de la situation de la recherche agricole dans chaque pays montre que le financement est la principale contrainte de leurs activités de sélection et d’amélioration des plantes par les méthodes conventionnelles ou traditionnelles depuis plusieurs décennies. Avec les OGM, la dépendance de l’extérieur s’avère alors inévitable pour l’alimentation et l’agriculture. Dans ce cas, comment parler de sécurité ou de souveraineté alimentaire si l’on doit dépendre de l’extérieur pour son alimentation ou des semences ?
De plus, les enjeux économiques, environnementaux ou écologiques, culturels et éthiques déjà évoquées renforcent l’importance des enjeux politiques des OGM.
Conclusion
Les multinationales comptent bien faire de l’Afrique un continent dépendant de leur OGM. Ils profitent ainsi de l’instabilité des pays africains et des faibles moyens économiques des ces Etats sous-développés. Es multinationales n’hésitent pas à profiter des faibles pour augmenter leurs profits qui seront redistribués entre quelques gros actionnaires jouant de la pauvreté du monde…
ATTAC, Greenpeace, Terre sacrée, ou encore Alerte OGM font partie des associations les plus puissantes et donc les plus représentées. Greenpeace ne compte pas moins de 3 000 000 d’adhérents dans le monde, ATTAC 21600 en France. Leurs actions sont nombreuses comme des fauchages d’OGM, des pétitions anti-OGM, de véritables investigations pour les plus puissantes comme Greenpeace.
Des parties politiques, écologiques pour la plupart, n’acceptent pas les OGM. Un des plus connus en France est "Les Verts". Ce parti ne milite pas simplement pour l’environnement mais pour une société plus sociale.
Tout d’abord, nous allons voir quelles sont les revendications des opposants aux OGM. Ensuite nous nous demanderons quels sont les atouts des OGM.
1) Les menaces sur l’environnement
Qu’est-ce que la biodiversité ?
Le grand scientifique américain, Edward O. Wilson, considéré comme l’inventeur du mot biodiversité, en donne la définition suivante : « la totalité de toutes les variations de tout le vivant »Selon les scientifiques, la biodiversité est la dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se décline en diversité écologique (les milieux), diversité spécifique (les espèces), et diversité génétique.
La biodiversité exprime deux notions essentielles :
- la biodiversité, c’est tout le vivant, y compris l’homme. C’est toutes les espèces végétales et animales recensées sur terre qui sont apparues naturellement.
- La biodiversité c’est aussi, les interactions existantes entre les espèces. Lorsqu’une espèce disparaît notamment à cause des Ogm, c’est tout une chaîne alimentaire qui est déstabilisée, c’est pourquoi d’autres espèces peuvent disparaître.
La perte de la notion d’espèce
Bien que les études scientifiques sur les risques des OGM ne soient pas nombreuses, certaines études ont tout de même réussi à en prouver certains.
D’une part, la notion d’espèce animale ou végétale vient à disparaître. Avec la technique des OGM, on pourra introduire un gène d’une espèce quelconque dans une autre espèce différente. La notion d’espèce vivante disparaîtrait, on ne parlera plus d’espèce mais de création par mélange.
D’autres part, les espèces végétales ou animales seront sélectionnés pour leurs qualités, qu’elles soient résistantes, qu’elles poussent vite. La diversité des plantes, des légumes est menacée. Le savoir faire des agriculteurs acquis au fil des générations ne sera que bagatelles. Une seule variété sera cultivée et les autres à cause de leur pauvre rendement disparaîtront.
Les menaces écologiques
La pollution
Tout d’abord, l’environnement sera de plus en plus pollué. Lorsqu’un gène qui a pour but de rendre une plante résistante à un insecticide est mise en place, l’agriculteur peut abuser de l’insecticide. L’environnement sera pollué, les nappes phréatiques et les rivières enregistreront une un taux de pollution accrue. Un exemple est l’introduction d’un gène tolérant le round up dans un soja transgénique par la firme Monsanto elle-même vendeuse de ce fameux round up. Cette firme augmente ainsi ses ventes d’insecticide, lequel est utilisé à tout vas par les agriculteurs.
Colonisation des OGM, atteinte à la biodiversité.
Les plantes transgéniques ont pour but de mieux résister aux prédateurs ou aux parasites naturels, ce qui leur confère un avantage comparatif par rapport aux variétés naturelles locales et risque de conduire à la disparition de ces dernières et donc à un appauvrissement de la biodiversité. Cela est particulièrement grave, car ce sont ces variétés locales qui fournissent les ressources génétiques nécessaires pour améliorer les plantes cultivées, qui deviendraient par exemple victimes de nouvelles maladies. Signalons aussi le danger économique que représenterait la dépendance du monde agricole vis-à-vis d'une multinationale unique pour son approvisionnement en semences de maïs ou de colza.
Atteinte à la biodiversité ?
Certains scientifiques estiment que la diffusion de la biotechnologie conduira à un appauvrissement de la diversité génétique, en conférant un même gène à de nombreuses espèces. Cet effet serait un facteur de vulnérabilité pour les cultures. Notons que d'autres pensent, au contraire que l'utilisation de transgenèses peut être un moyen d'augmenter la diversité génétique, en créant à partir de la même structure plusieurs plantes différentes ayant chacune des spécialités propres à elle seule, grâce à l'apparition de nouveaux gènes. Deux points de vue s’opposent mais un est indiscutable. Si les ogm colonise les territoires, cela se fera au dépourvu d’autres espèces naturelles, lesquelles disparaîtront.
Transmission de gènes par pollinisation et croisements inter variétaux
On sait aujourd'hui que les plantes cultivées échangent, par croisements spontanés, leurs gènes avec les espèces sauvages apparentées, qui sont souvent de mauvaises herbes. En France, des études récentes menées à l'INRA (Institut National de Recherche Agronomique) ont montré que le gène de résistance à un herbicide implanté dans le colza pouvait se retrouver dans une mauvaise herbe apparentée, la ravenelle. Celle-ci devient alors fertile et insensible aux herbicides, une super mauvaise herbe. Cela est encore plus grave si ce phénomène agit entre les cultures. Par exemple un maïs génétiquement modifié produisant une protéine contre un insecte pourrait contaminer un champ de colza aux alentours. Le colza produirait lui aussi cette protéine. L’agriculteur, croyant vendre un colza naturel vendra un colza génétiquement modifié. On appelle cela le flux de gènes Ce flux de gène génère une "pollution génétique" qui, à l'inverse de la pollution chimique ou radioactive, est totalement irréversible. On ne pourra jamais rapporter au laboratoire un gène qui se serait échappé de la plante génétiquement modifiée. Ce gène est et sera dans la nature pour toujours.
La résistance des insectes
Les maïs transgéniques dont la culture est aujourd'hui autorisée en France contiennent un gène de la bactérie du sol Bacillus thuringiensis qui synthétise dans la plante une toxine, dite Bt, qui lui permet de se défendre contre un insecte : la pyrale du maïs. Contrairement à un insecticide classique, que l'on utilise à des moments précis, la plante transgénique produit la toxine en continu. L'insecte, étant au contact de cet insecticide d'une façon quasi permanente, va très vraisemblablement y devenir progressivement résistant. La toxine Bt sera alors inefficace à moyen terme et l'on devra de nouveau recourir aux insecticides toxiques que ces maïs devaient nous permettre d'éviter, augmentant ainsi la pollution des sols et des eaux, ou à de nouveaux maïs transgéniques. A moyen terme, ce processus recommencera et cette escalade aura pour seul résultat une pollution accrue de l'environnement.
L’impact sur les insectes et notamment sur une activité : l’apiculture.
En effet, il est important de vérifier que les plantes transgéniques ne soient pas toxiques pour d'autres insectes .Ce sont les insectes qui ne sont pas considérés comme " ravageurs " et qui peuvent même être bénéfiques pour l'écosystème, voire pour tout l'environnement, d'où leur nom d'insectes " utiles ". Exemples : les abeilles, les coccinelles, …aucune étude actuelle n’a démontré que les OGM présentaient un risque majeur sur ces insectes. L’apiculture est directement menacée :
- risques non évalués dus à l'ingestion de pollens et nectar porteurs des transgènes et leurs produits, au premier rang desquels les insecticides produits par des cultures OGM qui pourraient provoquer la mort des colonies d’abeilles
- risques non évalués sur le transfert et expression de transgènes, y compris de résistance aux antibiotiques, dans les microorganismes de l'intestin de l'abeille, voire ses tissus.
Cependant, il faut nuancer ces risques. Lorsqu ‘un ogm permet de ne pas utiliser d’insecticide, il protège indirectement les abeilles car ces dernières sont souvent victimes de désherbages intempestifs.( partie B)
2) Des Menaces annexes
Les risques potentiels sur les humains consommant les organismes génétiquement modifiés.
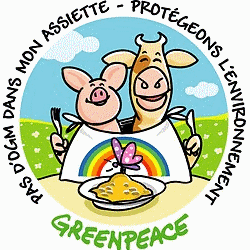 (Affiche de lutte anti-OGM)
(Affiche de lutte anti-OGM)Les risques alimentaires sont peu connus car ils n'ont été que très peu étudiés. C'est donc le principe de précaution qui doit s'imposer selon les personnes opposées aux OGM. Ces arguments sont à prendre avec recul car aucun test rigoureux n’a encore été effectué.
Recrudescence des allergies
Nous savons que les allergies sont dues aux protéines présentent dans le corps humain ou dans l’environnement en général. Or toute protéine est le produit de l’expression d’un gène. Donc un nouveau gène introduit dans une plante ou autre va produire une protéine qui pourrait déclenchée chez certaines personnes des allergies. En effet, cette protéine pourrait être rejetée par l’organisme.
La perte d’efficacité des antibiotiques lorsqu’un gène de résistance à un antibiotique est introduit dans une plante.
Parmi les gènes introduits dans le maïs transgénique de Novartis, autorisé à la culture en France, se trouve un gène de résistance à un antibiotique commun, l'ampicilline. Ce gène est un marqueur, c'est-à-dire qu'il permet d'identifier les plantes ayant intégré les gènes d'intérêt (de synthèse de la toxine Bt dans le cas du maïs). Ce gène n'a ensuite plus aucune fonction, mais Novartis n'a pas jugé utile de l'extraire des plantes transgéniques.Les études menées par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur les antibiotiques montrent que ceux-ci deviennent de moins en moins efficaces, les bactéries qui y sont soumises devenant insensibles au bout d'un certain temps. De nombreux scientifiques craignent que la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques à partir des plantes génétiquement manipulées n'accélère ce processus entraînant l'apparition de bactéries pathogènes contre lesquels les antibiotiques seraient impuissants. Il faut souligner que les antibiotiques sont les seules armes efficaces que nous possédons contre elles, que la recherche peine à trouver de nouvelles molécules efficaces et que les maladies hospitalières liées aux résistances aux antibiotiques tuent 10 000 personnes par an.
Le manque de recul quand à ce phénomène récent.
Ce problème majeur persiste et seul le temps et les études pourront le résoudre. En effet, la réalisation d’OGM est récente. Les dangers représentés par les OGM doivent s'apprécier en tenant compte du caractère très récent des développements de la transgénèse. Ce que la nature a mis plusieurs milliards d'années à construire, des hommes sont prêts à le contrarier en quelques années. La structure de l'ADN, support moléculaire de l'hérédité, n'est connue que depuis 1953. Les enzymes de restriction, ces ciseaux chimiques permettant de couper des portions d'ADN et de les insérer dans l'ADN d'un autre organisme, n'ont été découvertes que dans les années 70.
La première plante transgénique, un tabac résistant à un antibiotique, a été créée il y a quinze ans seulement, et la première commercialisation d'une plante transgénique date de 1994, sans qu'il y ait eu de recul par rapport à des phénomènes qui peuvent avoir des conséquences écologiques, économiques, sociales.
La transgénèse s'apparente aujourd'hui à une espèce de bricolage : on essaie et on verra les conséquences plus tard, qu’elles soient désastreuses ou pas. On connaît encore relativement peu de choses sur l'ADN, sur le rôle et le fonctionnement des gènes, leurs interactions. Peut –on implanté les gènes d’une espèce dans une autre sans que cela ne modifie en rien la structure de la plante, son fonctionnement ?
Malgré l'imperfection des connaissances en génie moléculaire, malgré l'impact potentiel des disséminations de ces plantes manipulées, dans aucune autre discipline les applications commerciales ne suivent d'aussi près les découvertes scientifiques, qui deviennent le baromètre de la santé des multinationales à la bourse. C’est ce que nous verrons dans le paragraphe suivant :
Pour les semences, les dix plus grosses entreprises contrôlent un tiers du marché des semences commerciales.Les premières entreprises semencières sont Dupont (par l'intermédiaire de Pioneer notamment), Monsanto (EUA), Syngenta (suisse), Bayer (allemande). La compagnie allemande KWS AG est septième.
l’agriculture en danger
Comme vous pouvez l’observer sur la carte suivante, les OGM sont cultivés dans toute l’Amérique, en chine, en Inde et en Australie et dans quelques pays européen sans oublier l’Afrique du sud. Les principales plantes modifiées cultivées sont le maïs, le colza, le soja et le coton.
En chine, les multinationales se sont implantées sans aucune difficulté. La population chinoise augmente alors que la production de riz stagne. Les multinationales se sont déjà emparées d’une partie du marché agricole en Chine et les agriculteurs se voient dans l’obligation d’accepter ces semences transgéniques, c’est pourquoi l’agriculture est en danger
des agriculteurs dépendants
Le risque économique se pose en terme de dépendance des cultivateurs envers l’entreprise détentrice du brevet, ceux-ci devant payer chaque année une contrepartie financière pour avoir le droit de planter les semences concernées par le brevet. En effet, les brevets confèrent à l’entreprise l’exclusivité des reproductions des semences transgéniques. Il est vrai que la directive 98/44 n’autorise pas ces pratiques mais elle n’a pas encore été adoptée en France et dans de nombreux pays européens.
De tout temps, les paysans ont conservé une partie des graines obtenues pour les replanter la saison suivante. Ce “droit de l’agriculteur” est perçu par l’industrie des semences comme un “privilège du fermier” et une concurrence insupportable, face aux coûts grandissants de la recherche. En Amérique du Nord, plusieurs centaines de fermiers ont été poursuivis en justice par Monsanto pour avoir ressemé des variétés transgéniques brevetées. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien qui n’a jamais cultivé d’OGM, a été condamné pour recel de gènes brevetés par Monsanto dans sa culture de colza ! Les semences transgéniques brevetées sont souvent comparées à des logiciels informatiques du point de vue de la propriété intellectuelle ; elles ne peuvent légalement être multipliées par leurs utilisateurs. D’une année sur l’autre, les agriculteurs sont contraints par la loi d’acheter leurs semences au lieu de les reproduire. Dans les pays du Sud, outre l’aspect économique, ces pratiques de sélection et multiplication des semences locales servent à maintenir une diversité variétale adaptée à une large gamme de terroirs ; ces pratiques sont favorables à la conservation des ressources génétiques vitales pour l’humanité.
Des OGM incontrôlés
Un scandale a éclaboussé la chine. Des chercheurs de Greenpeace ont découvert que Des semences transgéniques sont vendues et cultivées illégalement dans la province chinoise de Hubei depuis 2 ans. Des échantillons de riz ont été récupérés auprès de revendeurs de semences, de paysans et de meuniers. Les analyses effectuées par le laboratoire international Genescan ont montré la présence d’ADN transgénique dans 19 échantillons. Ce marché « noir » des OGM prouve encore une fois que ces plantes ont plus un but commercial que alimentaire. selon une conseillère de green peace ce problème est grave car les analyses effectuées ont montré la présence d’une protéine soupçonnée de provoquer des allergies sur les consommateurs.
La recherche publique concurrencée et bafouée
Face à des contraintes économiques, à l’obligation de trouver de nouveaux débouchés et de créer de nouveaux marchés, des partenariats s’installent entre entreprises privées et publiques. Les nouvelles législations sur la recherche et l’innovation favorisent le rapprochement des universités et des grandes entreprises, qui peuvent ainsi imposer leur conception marchande du vivant. Par exemple, aux États-Unis, Novartis et Monsanto ont pris le contrôle de départements de recherche, respectivement de l’Université de Berkeley en Californie et de la Washington University, pour des contrats de centaines de millions de dollars. Les détenteurs de brevets n’acceptent de délivrer le matériel breveté qu’à condition d’avoir un compte-rendu régulier des recherches entreprises par les concurrents. Des chercheurs du domaine public, le plus souvent sous contrat avec le secteur privé, adoptent peu à peu la politique du secret. Le risque majeur de ces contrats est de voir les firmes biotechnologiques s’emparer de la recherche et où les états ne pourront que subir.
L’expansion illimitée des brevets
Si les lois encadrant la brevetabilité du vivant continuent à s’élargir, l’appropriation du patrimoine universel va se banaliser. N’importe qui, voulant déposer un brevet sur un organisme vivant (plante, animal) le fera sans aucunes contraintes. Les grandes firmes pourront ainsi développer toutes leurs capacités financières pour créer de nouveaux êtres vivants et les breveter. En effet, les coups des brevets sont très important et seuls les multinationales peuvent se permettre d’organiser les recherches et de déposer les brevets. On peut imaginer que le vivant sera dans un certain nombre d’années propriété de ….
Etude des dangers de l’implantation des OGM dans les pays du sud par les firmes : exemple du continent africain.
Les enjeux économiques
Nous savons tous que la production d’OGM coûte chère. Elle nécessite de la part des gouvernements de débloquer des fonds importants. Ainsi, la recherche sur les OGM n’est pas une priorité pour les pays pauvres, en voie de développement, et même certains pays riches. C’est pourquoi, la recherche et la production d’OGM sont souvent réalisées par des multinationales. Et qui dit multinationale, dit forcément profit. Les OGM constituent bien un enjeu économique considérable. Toute activité de recherche doit être rentabilisée par les activités commerciales de l’entreprise. De ce fait, pour trouver de débouchés à ces produits indésirables en Europe, l 'Afrique risque d 'être leur terrain de prédilection, sous prétexte que ce continent souffre de la faim. Or, il est bien connu que l 'Afrique produit suffisamment de nourriture pour nourrir tous ses fils, et que le problème crucial reste le transport des produits alimentaires entre des régions d’un même pays, ou entre des pays de différentes régions, comme c’est également le cas en Asie et en Amérique Latine. De plus, l 'Afrique dispose encore de ressources génétiques alimentaires non encore exploitées par la recherche scientifique nationale qui a du mal à financer ses activités la plupart du temps.
Ainsi, les intérêts économiques des sélectionneurs et des multinationales sont protégés, au détriment de ceux des agriculteurs et des communautés locales. Ces intérêts économiques des producteurs d 'OGM sont les principales raisons de l 'offensive actuelle des multinationales et de certaines coopérations des pays européens, sur toute l 'Afrique, ses organisations régionales ou sous-régionales (CEDEAO, UEMOA), et chacun des pays africains. Cette offensive vise à les contraindre à accepter sans précaution et sans tarder, l’introduction des OGM. Tout ceci n’a qu’un seul but, le profit.
De plus, les OGM produits par les entreprises ne font pas souvent l’objet de contrôle. L’offensive des multinationales en Afrique n’est donc pas contrôlée car très peu d’Etat africain est en mesure d’effectuer des tests rigoureux sur l’OGM qui sera peut-être cultivé chez eux demain. C’est le cas du coton Bt qui ne contrôle pas tous les insectes qui prolifèrent sur le coton en Afrique de l’Ouest. De ce fait, bien qu’en payant chère les semences transgéniques, le gain prétendu par la réduction de l’utilisation des pesticides n’est pas vérifié.
Les enjeux culturels et éthiques
En Afrique comme partout dans le monde entier, la diversité culturelle est liée à la diversité culinaire et à la diversité génétique. Quelles seraient les conséquences des modifications de la diversité génétique sur la diversité culturelle ? Par ailleurs, les interdits alimentaires ou les totems font partie des réalités africaines dans la plupart des villages et des régions. Que se passerait-il avec les OGM ?
Des échanges interdits.
Il importe de rappeler que les semences qui servent de point de départ à la création de variétés améliorées ou transgéniques sont issues des travaux de sélection et de conservation des agriculteurs et des communautés locales pendant des générations, des siècles ou des millénaires. Or, les droits des agriculteurs et des communautés locales ne sont pas reconnus au même titre que les droits de propriété intellectuelle des sélectionneurs et des producteurs d 'OGM. Il faut préciser que le brevetage du vivant est contraire à l’éthique africaine, qui a toujours consacré la propriété collective des semences et l’échange de ces dernières entre paysans, parents ou amis.
Toutes ces pratiques d’échanges de semences sont interdites avec les OGM. Les OGM, détenus par les multinationales ont fait l’objet d’un brevet et ils sont et ils restent l’exclusivité de l’entreprise. Un agriculteur achetant des semences transgéniques n’a en aucun cas le droit de les échanger avec un autre agriculteur. Et encore, il n’a le droit de ramasser les graines pour l’année suivante. Ainsi, on ignore les droits des agriculteurs et des communautés locales. Or, le groupe Afrique auprès de l 'Organisation Mondiale du Commerce à Genève a rejeté depuis le Sommet de Seattle en 1999, le brevet sur le vivant, et depuis Juillet 2001, les chefs d 'Etat de l 'Union Africaine ont adopté la loi modèle de l 'OUA sur la " Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs, et règles d’accès aux ressources biologiques ". Mais jusqu 'à ce jour, rare sont les pays qui ont légiféré pour protéger les droits des agriculteurs et des communautés locales de leur territoire national.
Une atteinte à la culture et aux coutumes
Enfin, les OGM posent également d’autres problèmes éthiques, dans la mesure où la barrière naturelle entre les espèces n’existe plus. En effet, les gènes insérés dans la plante améliorée viennent souvent d’une espèce étrangère. L’on peut même insérer un gène d’une espèce animale dans une espèce végétale et vice-versa. Connaissant l’importance des espèces animales et végétales dans la vie quotidienne des africains, à savoir l’alimentation, l’artisanat, la santé, et surtout la spiritualité, avec les interdits alimentaires, les totems,…, il y a lieu de se poser des questions à propos des OGM en Afrique. En effet, la contamination des plantes et des animaux par des OGM constitue une attaque à ce dont l'Afrique dispose de fondamental et de sacré, son patrimoine génétique (plantes et animaux d’Afrique).
Les enjeux politiques
Les multinationales accourent vers l’Afrique car elles y voient un marché formidable. Par leurs moyens financiers importants, elles exercent une pression sur des Etats africains faibles, pauvres dont on connaît leur fragilité. En effet, depuis les indépendances, les pays africains ayant toujours du mal à financer leur recherche scientifique agricole, l 'acceptation des OGM entraîne nécessairement la dépendance des pays africains vis-à-vis des multinationales et des laboratoires internationaux pour les semences et l 'alimentation. En effet, l’analyse de la situation de la recherche agricole dans chaque pays montre que le financement est la principale contrainte de leurs activités de sélection et d’amélioration des plantes par les méthodes conventionnelles ou traditionnelles depuis plusieurs décennies. Avec les OGM, la dépendance de l’extérieur s’avère alors inévitable pour l’alimentation et l’agriculture. Dans ce cas, comment parler de sécurité ou de souveraineté alimentaire si l’on doit dépendre de l’extérieur pour son alimentation ou des semences ?
De plus, les enjeux économiques, environnementaux ou écologiques, culturels et éthiques déjà évoquées renforcent l’importance des enjeux politiques des OGM.
Conclusion
Les multinationales comptent bien faire de l’Afrique un continent dépendant de leur OGM. Ils profitent ainsi de l’instabilité des pays africains et des faibles moyens économiques des ces Etats sous-développés. Es multinationales n’hésitent pas à profiter des faibles pour augmenter leurs profits qui seront redistribués entre quelques gros actionnaires jouant de la pauvreté du monde…
page 13


